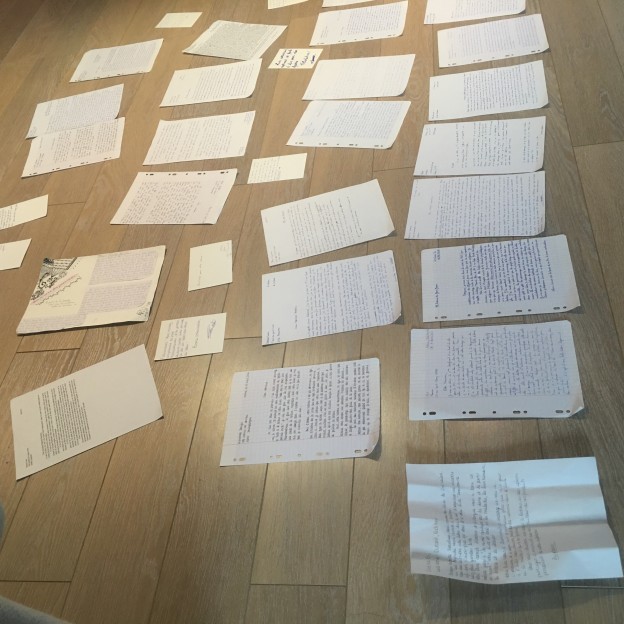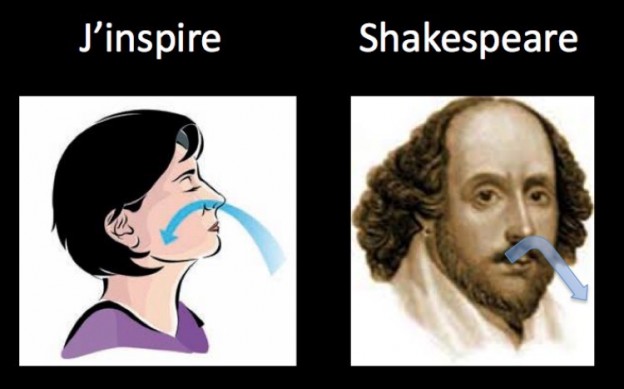Texte envoyé par une patiente (j’ai laissé tel quel). Je relaie ce texte de femme, car nous sommes tous concernés. Tous. La maltraitance médicale, c’est ça. Il faudrait que TOUS les étudiants dans les métiers du soin lisent ça. À partager. Nous traitons avec des âmes qui ont un corps, pas avec des corps sans âmes.
Merci à C. (je n’ai pas mis de photos, parce que j’ai pas de mots devant ce qu’elle raconte…)
Alors voilà, c’est l’histoire d’une naissance et d’une séquelle, c’est l’histoire d’un corps, et des regards que l’on porte dessus, c’est l’histoire de mots que l’on entend pas, c’est l’histoire d’un homme et de femmes…
Ce 24 Mars 20xx, j’ai accouché d’un beau petit gars, 3,980 kgs…. Primipare, désir d’accouchement naturel, l’emmerdeuse au projet de naissance, pas vraiment soutenue, qui, après s’être rendue à la maternité a 1h du matin et errée dans les couloirs de la maternité pendant plusieurs heures sous les regards « rigolards » du personnel qui me disait, « alors, toujours pas de péri ?» , ben si… Une naissance belle, simple par rapport à tant d’autres (même si baisse de tension et hémorragie), mais un sentiment amer d’une dépossession de soi, de ce moment.. Je ne voulais pas d’épisio, je sais, c’est con, ça pourrait se déchirer, jusqu’à l’anus, jusqu’au périné…. Mais j’en voulais pas… on m’ a pourtant coupée, sans m’avertir, sans me demander, sans m’en parler… il m’a coupée comme un découpe un bout de steack à l’heure du déjeuner…. Cette épisio a eu du mal à cicatriser, des douleurs, des oedèmes, lorsque je m’en plaignais pendant les soins à la maternité, les aides soignantes me disait de ne pas faire ma « chochotte »…. Souffre, mais fais-le en silence s’il te plait… déni de mon corps, déni de ma douleur… douleur pour uriner, l’horreur d’imaginer aller à la selle pour la première fois depuis ce changement de corps..un interne a cependant compris, m’a donné une poche de glace à appliquer, pour le diminuer, ce satané oedème… j’avais une trompe d’éléphant gelée entre les cuisses, mais j’avais un beau bébé en bonne santé contre mon sein…
Une sortie de mater, s’asseoir à la maison sur une bouée, c’est marrant la bouée quand on a 26 ans et qu’on sait nager… ça tire pourtant, ça brule, ça gène… Mais bon, il paraît que c’est normal, et puis j’ai pas de quoi me plaindre, j’ai un enfant en bonne santé !
Rendez-vous quelques semaines plus tard avec le gynéco. Contrôle de l’épisiotimie :
<< – Douleur ?
– Oui.
– Ça va passer ! L’oedeme s’est bien resorbé, La cicatrice est belle, peut etre un peu serrée, mais ca va aller. >>
Première étreinte, parce que, même si on est devenu papa et maman, une fois que tout redevient un peu normal, on a envie de se retrouver, et puis, malgrè tout, on reste humain… La pénétration est douloureuse, dès les premiers mouvements, elle s’emplifie, terrible, inonde mon corps entier d’une douleur indescriptible… Culpabilité, serrer les dents, ne pas crier… faire un effort, il paraît que c’est normal la première fois après une épisio, un peu comme un nouveau dépucelage ? Mais mon mari, c’est pas un rapide, il veut faire les choses bien, lentement, il prend son temps, moi, je rêve que ça s’arrête, m’agrippe aux oreillers… il prend ça pour du plaisir, mon mâle. Et soudain, les larmes coulent, je ne peux pas, je m’écarte, lui demande pardon, pardon de ne plus être celle qu’il aimait, pardon de ne plus pouvoir partager ce plaisir…
Nous retenterons à plusieurs reprises, mais la douleur est toujours aussi intense, aussi envahissante, aussi déchirante… Quelques semaines plus tard, je revois l’obstétrictien qui m’a recousue, je lui fais part de mon malaise, de ma douleur… il dédramatise, et me dit, « Vous inquiétez pas, on reprendra cette épisio a votre prochain accouchement ! » Mais mon grand , tu n’as pas compris ! Je ne m’appelle pas Marie, et pour accoucher, ben faut faire un bébé et ça ne se fait pas par le nombril !
À plusieurs reprises dans les mois qui suivent, je reviens dans ce petit hopital où je ne suis pas écoutée… jusqu’au jour ou, par un beau mois de mai, une interne m’examine, et lorque je lui parle de mes douleurs, de mon absence forcée de vie sexuelle, de ce sentiment de honte… se met à regarder d’un peu plus près… et appelle ce fameux obstétricien, mon grand boucher…. Après une discussion -à laquelle je ne suis pas conviée- il m’indique qu’il va m’opérer, “reprendre l’épisio”, qu’il me dit…
Ce matin-là, en juin, soit un an et 3 mois après la naissance de mon fils, je rentre à l’hopital en gynécologie… douche de bétadine, charlotte sur la tête, brancard, nue sous ma blouse…. Salle d’opération… Ça doit se dérouler sous anesthésie locale… L’équipe se prépare, je suis là, installée, pattes écartées, les gens s’affairent autour de moi, ça papote, ça rigole aussi…Moi je suis terrifiée… Il entre ,mon boucher, il entre, et sort sûrement d’une opération, enfin, je le suppose, et peut-être au fond de moi, l’espère, car il est là, à tourner dans cette salle, torse nu, torse poilu, et moi pattes écartées, avec mon sexe exposé…. Il est là et je ne peux plus l’écouter, je me renferme dans ma bulle, je vois ses poils et je voudrai juste m’enfuir.. il met une blouse et s’installe….. entre mes cuisses…. Une femme s’approche de moi, me parle. A-t-elle compris mon angoisse ?…. Elle s’asseoit à mes cotés, me prend la main, je m’excuse doucement…. Je demande à l’homme au ciseau ce qu’il fait… Besoin de me rassurer, de savoir, de comprendre, « va t’il recouper au même endroit ? Comment cela se passe ? Est-ce qu’il comprend pourquoi j’avais mal ?» il me demande de me taire, de le laisser travailler, que je l’embête avec mes questions sans arrêt… je serre un peu plus fort la main qui me tient, la serre à la broyer, et pleure, doucement, tout en m’excusant, doucement… à cette femme qui est à mes cotés.. elle me sourit, essuie les larmes qui ruissellent… Condamnée au silence, je ne peux que pleurer…. Je ne mesure pas le temps, juste ce sentiment de dépossession, encore…. Ce sentiment d’un corps objet, ce sentiment du regard d’homme sur mon corps meutri… Il a fini, il semble fier de lui… et s’en va… je suis rentrée, ai retrouvée ma copine la bouée… Mais une épisio, sans nouveau-né, ça fait pas trop dans les clichés…. Les gens ne comprennent pas forcément, et on a pas non plus envie d’en parler, hein…
Je n’ai jamais pu savoir pourquoi cette épisiotomie avait dû être reprise… je n’ai jamais compris les mots qu’avaient utilisés cette jeune interne pour faire comprendre mon mal, pourquoi….
Depuis, j’ai eu un autre enfant, une poupette, née en 2009…dans un autre hopital…. Toujours l’emmerdeuse au projet de naissance…. Aux premières contractions, un souhait de ne pas me presser, d’attendre le dernier moment, de profiter du calme de ma maison, de me respecter… un bain, un bon livre, mon ballon d’accouchement, des chansons, de la musique, le calme d’une nuit de novembre au coin du feu…Une arrivée tardive à la mater, à 7 doigts ! Une sage femme à l’écoute, encourageante, et respectueuse…. Une poupette arrivée 1h après avoir passée la porte de la maternité, sans péri, mais… coupée…..
Alors voilà, 3 épisiotomies et deux enfants… une douleur dans les chairs que je porterai toute ma vie… Des séances d’osthéopathie ont un peu amélioré, mais la zone reste très sensible… Mais je n’en parlerai plus…. Car la douleur est à présent intériorisée… on sert toujours un peu les dents au moment des rapports… l’alcool aide aussi, permet de s’évader et de mieux se détendre… ben oui, une épisio peut nous mener la… C’est con, je trouve, mais voila….