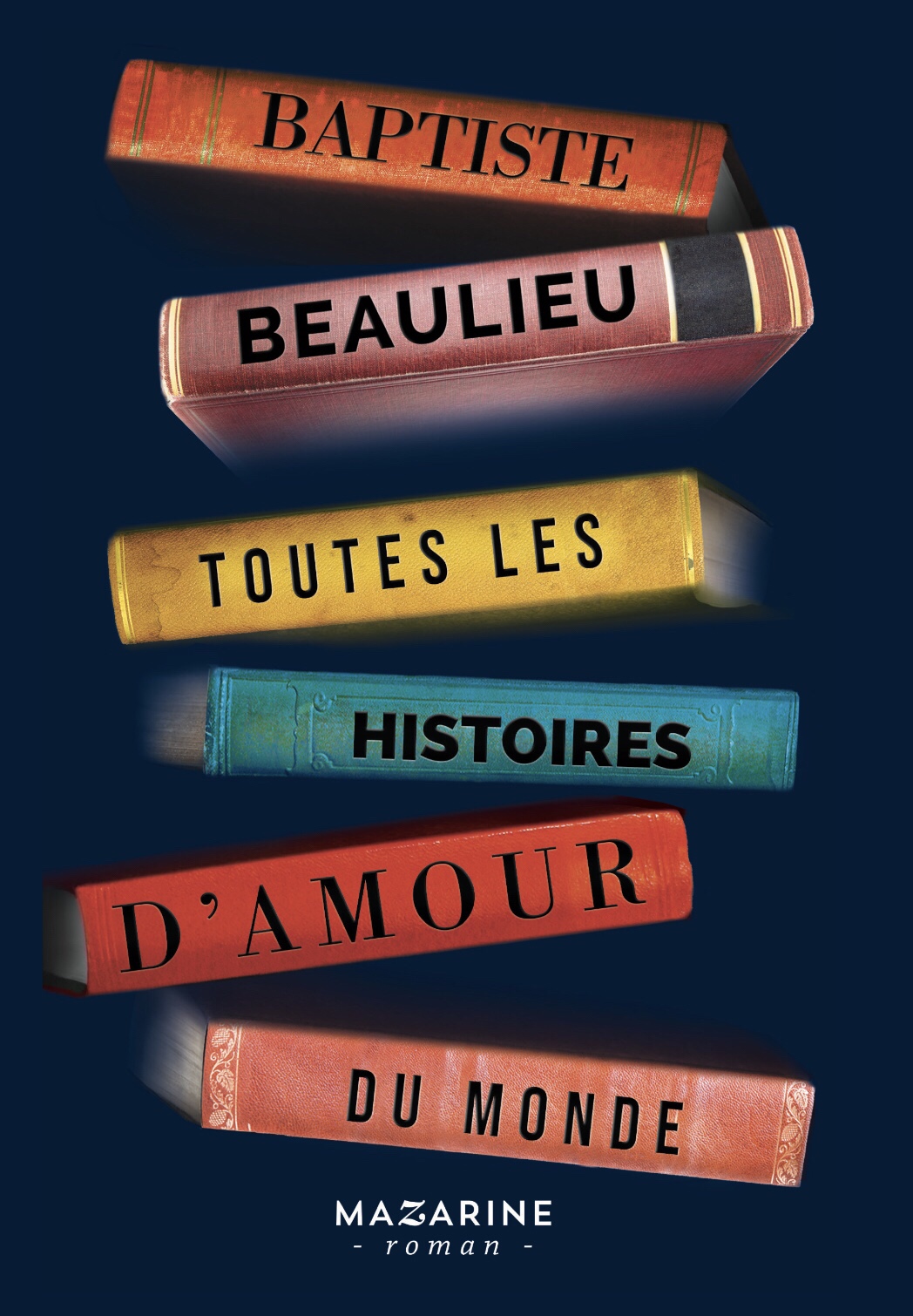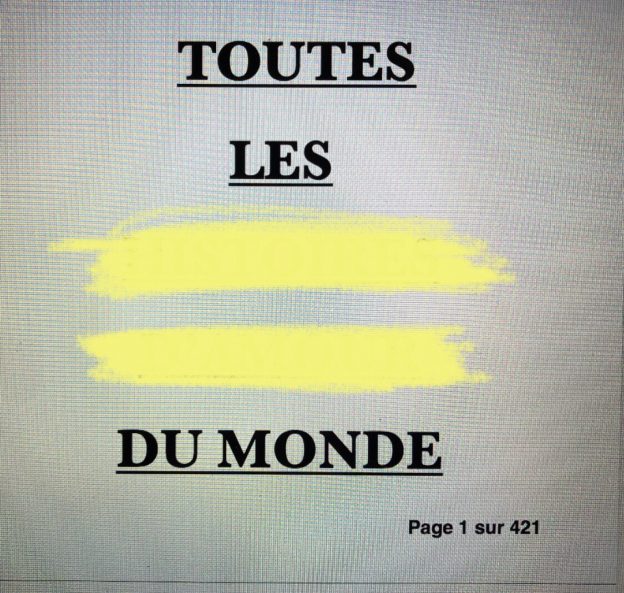Texte écrit par la romancière Caroline Boudet
Alors voilà, j’avais vraiment l’intention de n’avoir ni à écrire, ni à publier ce post. Vraiment. Parce que tout devait se passer pour le mieux, et il n’y avait pas de raison que ça se passe autrement, n’est-ce pas ?
Mais ce soir, trop c’est trop.
Ce soir 29 juin, cela va faire plus de 7 mois que nous, parents de Louise, qui a trois ans et demi et un chromosome en plus, bossons pour qu’elle fasse sa rentrée dans les meilleures conditions en septembre prochain.
Vous voulez savoir, ce que c’est, bosser pour que son enfant handicapé fasse sa rentrée en petite section, en 2018 en France ?
En novembre 2017 nous avons commencé à rassembler tous les papiers nécessaires pour faire une demande d’AVS (Auxiliaire de vie scolaire). Pourquoi tellement à l’avance ? parce que la MDPH, l’administration qui décide des attributions d’aide humaine pour les personnes handicapées, met en moyenne 5 mois dans notre département à traiter des dossiers de demande – c’est une moyenne basse pour la France.
Tellement à l’avance, parce que nous voulions arriver au mois de mai ou juin et avoir ce sesame officiel qui permet à l’éducation nationale d’embaucher quelqu’un, et que nous voulions que cette personne soit là dès la rentrée. Parce que nous voulions FAIRE LES CHOSES AU MIEUX.
Donc, dès novembre, nous avons : rempli un dossier de demande de 20 pages, recueilli des certificats médicaux, détaillé les journées de Louise, expliqué par écrit quel était son « projet de vie » à trois ans, et pourquoi il nous semblait au mieux pour elle, après la crèche ordinaire auprès de ses camarades, d’entrer en maternelle avec les autres. Après tout, l’ère du temps est à l’inclusion, n’est-ce pas ?
Et bien l’inclusion c’est ça, donc : préparer 10 mois à l’avance une rentrée scolaire sur le plan administratif. Attendre cinq mois. Recevoir une « notification », papier sans âme qui vous annonce une décision que vous ne comprenez pas : « attribution d’une AVS mutualisée ». Chercher à comprendre ce que cela veut dire, combien d’heures elle sera avec Louise, quand elle arrivera, qui l’attribuera ?
C’est comprendre que «AVS mutualisée », c’est une personne dont le temps sera partagé entre plusieurs enfants, peut-être sur plusieurs écoles différentes.
C’est demander « combien ? et combien d’heures auprès de Louise ?
C’est au mieux entendre « on ne peut pas vous dire, 10 h par semaine au maximum, et quand ? on ne sait pas », au pire n’avoir aucune réponse.
C’est entendre, quand on évoque le projet de scolarisation, comme première réponse « mais vous avez pensé à prolonger la crèche ? ». Une fois. Deux fois, trois fois. C’est avoir peur, en effet de faire une FOLIE, prendre des avis, comprendre qu’une petite section avec trisomie 21 n’a rien d’un voyage sur la Lune. C’est faisable. C’est souhaitable.
Alors on a refait un dossier, avec re- un certificat médical, et re- les avis des pros qui suivent Louise, pour expliquer que ce serait vraiment mieux pour tout le monde, enseignants comme élèves, que notre fille bénéficie d’une AVS pour davantage d’heures que « 10 maximum par semaine ». C’est qu’avec des classes de 25 à 30 en petite section, on peut comprendre aussi en tant que parents que rien ne soit évident et avoir envie de faciliter les choses. Et on avait vraiment, vraiment envie de rassurer tout le monde pour que Louise ait une rentrée sereine.
L’inclusion, c’est de nouveau envoyer ce dossier, en avril, en plusieurs exemplaires, en courrier suivi, en recommandé. Et attendre qu’il soit réceptionné. Et appeler deux fois, trois fois, cinq fois, pour entendre en juin « Mais oui on l’a reçu le 14 mai, mais alors là, vraiment, on ne pourra pas l’examiner avant septembre ».
Pourquoi pas, mettons toutes les bonnes volontés avec nous pendant ce temps, rencontrons l’équipe pédagogique, organisons une réunion avec 13 personnes autour de la table. 13 personnes, vous voyez le truc : impressionnant, n’est-ce pas, quand on se souvient qu’on prépare une petite section de maternelle et pas le prochain sommet de l’Otan.
Mais vaille que vaille, c’est utile, dépassons nos appréhensions et discutons avec ces personnes autour de la table qui sont motivées pour aider Louise à faire au mieux son entrée dans l’école. On est en juin, tout semble prendre forme, l’école prête à l’accueillir, l’enseignante et l’Atsem rencontrées, le centre de loisirs dans les starting-blocks, la kiné, l’orthophoniste et la psychomotricienne prêtes à se déplacer à l’école comme elle le font à la crèche, pour les séances de rééducation de Louise.
Alors, même si la grande inconnue reste en juin cette histoire d’AVS, prenons d’une main un anxio, de l’autre notre mal en patience, c’est ça l’inclusion, et on va y arriver. Attendons septembre, toutes les bonnes volontés sont là, c’est ça l’inclusion.
Et puis BAM, fin juin, un coup de fil qui nous apprend que finalement, ça n’est plus « du tout » possible que les pros qui suivent Louise continuent à venir la voir dans l’école. Pourquoi ? Euh, on ne le fait pas. Ce qu’il faut c’est que les parents viennent la chercher à l’école et l’emmènent à son rendez-vous. Ou alors payez une baby-sitter pour l’emmener.
Et d’ailleurs, si on vous appelle, c’est pour vous demander si vous avez envisagé que votre fille reste un peu plus longtemps en crèche. (Cinq fois).
Alors là, toi t’es mère, mais tu es aussi secrétaire, GO, greffière, administratrice, j’en passe et des meilleures depuis huit mois, tu es sur les rotules. T’as donné toute ton énergie parce que l’inclusion, oui tu y crois. Mais là t’as les jambes qui flageolent et la voix qui tremble. Parce que le message qu’on te balance, avec cette question répétée, n’est pas du tout : « bienvenue à l’école de la République».
Alors puisque sur cette page on partage les progrès, les joies, les peines, les réalités sans fard de la vie avec un enfant porteur d’un handicap, ce soir je vous raconte ma colère, mon effondrement, mon écoeurement mon sentiment d’injustice et surtout de solitude face à tout cela. Ça fait huit mois, et on revient à la case départ. Et maintenant, on fait quoi ?
Maintenant, quand vous entendrez cette petite phrase « oui, il/elle va aller à l’école, on a fait toutes les démarches pour », vous saurez ce qu’elle cache pudiquement dans la vie des familles.
PS : Et je me dois de préciser malheureusement que nous sommes dans une situation qui est loin d’être la pire.
Caroline Boudet